Actualités
Géotechnique, une pierre angulaire coûteuse pour la « PI »
Article de journal

En bord de Garonne à 20 km en amont de Bordeaux, la communauté de communes de Montesquieu veut régulariser les digues de ses casiers historiques. Mais le sol argileux en profondeur nécessite des campagnes géotechniques approfondies.
« La Garonne s’incise de plus en plus, depuis qu’elle a été pillée de sa grave (les sédiments présents dans son lit). Ce phénomène crée une érosion violente, avivée par la transgression marine et visible à chaque gros coefficient de marée », explique Emmanuel Norena, responsable du Pôle Environnement (7 personnes, dont 2 sur les digues) à la communauté de communes de Montesquieu. Regroupant 13 communes pour environ 46.000 habitants, l’intercommunalité exerce la compétence Gemapi depuis 2014. Pour la partie Prévention des Inondations (PI), elle a hérité de 75 ouvrages hydrauliques et quelques 20 km de digues, principalement des digues de casiers agricoles qui étaient gérées par des Associations Syndicales Autorisées (ASA). La moitié du linéaire des digues est en mauvais état, régulièrement victime de brèches et de débuts d’érosion qui menacent des habitations situées sur les communes de l’Isle-Saint-Georges et Cadaujac. Depuis 2016, le service d’Emmanuel Norena bataille pour faire régulariser et entretenir ces digues. Une trentaine d’évènements importants pour la sureté hydraulique (EISH) ont dû être déclarés. Dans le cadre de la procédure d’autorisation du système d’endiguement et face à la fragilité de ce linéaire, l’Etat a demandé que soient réalisées des études géotechniques.

Erosion en bord de Garonne (crédit CC Montesquieu)
Manque d’entretien, argile vasarde
La problématique complexe qui caractérise la gestion des digues découle d’une combinaison de facteurs, qui s’additionnent à l’incision du fleuve. L’un d’entre eux est le manque historique d’entretien sur certains casiers, en particulier situés au nord. « Sur les bocages en bord de Garonne, il y eu de la déprise agricole, c’est-à-dire une cessation d’activité et l’association syndicale autorisée n’entretenait plus les digues », explique Emmanuel Norena. Un autre facteur qui complique la situation est la forte proportion d’argile dite « vasarde » dans les berges. Ce type d’argile, présent en profondeur, complique l’entretien et le renforcement des digues. « On a sur certains secteurs de l’argile vasarde au-delà de 8 mètres de profondeur. Or au-delà de 8 m, vous ne pouvez pas poser d’enrochement. Et au-delà de 10 voire 15 mètres, on n’a pas de garantie que les palplanches se maintiennent. C’est un écueil technique très fort », poursuit Emmanuel Norena.
Régulariser tout, ou partie
Dans une optique de solidarité avec les habitants situés près des casiers du nord, en 2020 les élus de l’intercommunalité ont voté la reprise en gestion de l’ensemble des casiers, contrairement à la décision des élus précédents de ne reprendre que les digues situées au sud du territoire. L’équipe technique Gemapi a alors préparé le dossier de demande de régularisation (autorisation simplifiée), afin de pouvoir ensuite réaliser des travaux de rénovation des ouvrages. Le dossier initial prévoyait une protection contre une crue de période de retour annuel, autrement dit, minimale, du fait de l’état dégradé. Mais les services de l’Etat ont demandé que soient effectuées des analyses géophysiques et géotechniques approfondies, en préalable à l’autorisation administrative. Pour ce faire, une dérogation au délai d’autorisation a été accordée jusqu’en août 2025. La caducité de l'autorisation des digues, précédemment fixée au 1er juillet 2024, a été reportée au 1er septembre 2025, selon un arrêté préfectoral signé en août 2024.

Erosion en bord de Garonne (crédit CC Montesquieu)
Géophysique à haut rendement
« La géotechnique, c’est la pierre angulaire aujourd’hui des éléments que nous demandent les services de l’Etat, tant par rapport aux diagnostics liés à l’Etude de Dangers que pour l’aboutissement des EISH », explique Emmanuel Norena. Dans un premier temps en 2024, le bureau d’études géotechnique mandaté a piloté une reconnaissance géophysique par méthode électromagnétique. Ce type de campagne « à grand rendement » permet de scruter rapidement un linéaire important. Ici la mission a exploré les 19,5 km de linéaire, avec un appareil conductivimètre (CMD Explorer) portable. L’objectif était de cartographier les gisements de graves à faible profondeur, autrement dit les secteurs les moins fragiles en profondeur. « La géophysique permet de cibler les zones à sonder (carottage ou pénétromètre) en géotechnique et donc de gagner en efficacité et de réaliser des économies, car les sondages géotechniques représentent une dépense lourde », ajoute le responsable du pôle environnement.
Une dizaine de secteurs ont ainsi pu être identifiés fin 2024, où potentiellement la digue aurait la capacité à tenir le niveau de protection qui a été défini lors du classement initial (fait en 2016 sur la base du décret digues de 2007). L’idée de cette géotechnique complémentaire est d’augmenter la part du linéaire avec une cote de sureté supérieure au terrain naturel, sachant que dans le dossier initial, 50% du linéaire était associé à une cote au niveau du terrain naturel…
Sondages géotechniques
Les sondages géotechniques devaient commencer avec l’arrivée du printemps 2025, quand le sol aura une portance suffisante pour permettre l’incursion des machines. « Avec les travaux sur la ligne à grande vitesse Toulouse Bordeaux, nous avons eu du mal à avoir des bureaux d’étude géotechniques disponibles », signale Emmanuel Norena, qui anticipait de devoir solliciter une nouvelle dérogation au délai de régularisation des digues.
Pensé dans un esprit de solidarité, le choix de reprendre les digues casiers sous gestion intercommunale se révèle plus coûteux que prévu. Après 120.000 euros en 2024 pour la campagne géophysique, l’intercommunalité escomptait plus de 100.000 euros d’études géotechniques en 2025. Seul une petite partie sera financée par l’Etat, grâce au PAPI de la Garonne Girondine.
Une fois que les secteurs les moins instables auront été identifiés et l’étude de dangers actualisée, le dossier d’autorisation simplifié devrait pouvoir être validé par les services de l’Etat. Le bloc communal pourra alors préciser le programme de travaux de sécurisation. Des enrochements, des palplanches et un recul partiel des digues sont envisagés. La zone protégée finale pourrait concerner 100 à 150 personnes.
Sur la Garonne, le phénomène d’érosion fluviale ne se pose pas qu’à Cadaujac et L’isle-Saint-Georges, mais aussi bien plus en amont. A la confluence du Lot et de la Garonne, le petit village de Monheurt était lui aussi habitué aux crues, mais celles-ci ont fini par grignoter la berge au point de menacer l'école communale. Le maire a même pris « un arrêté pour interdire l'accès aux jardins des maisons et aux sentiers de la berge », racontait France 3 Nouvelle Aquitaine, en 2024.
Enrochements ou relocalisations, le dilemme ne concerne pas que les communes littorales.
Sources :
Contributeur
Structure
Licence
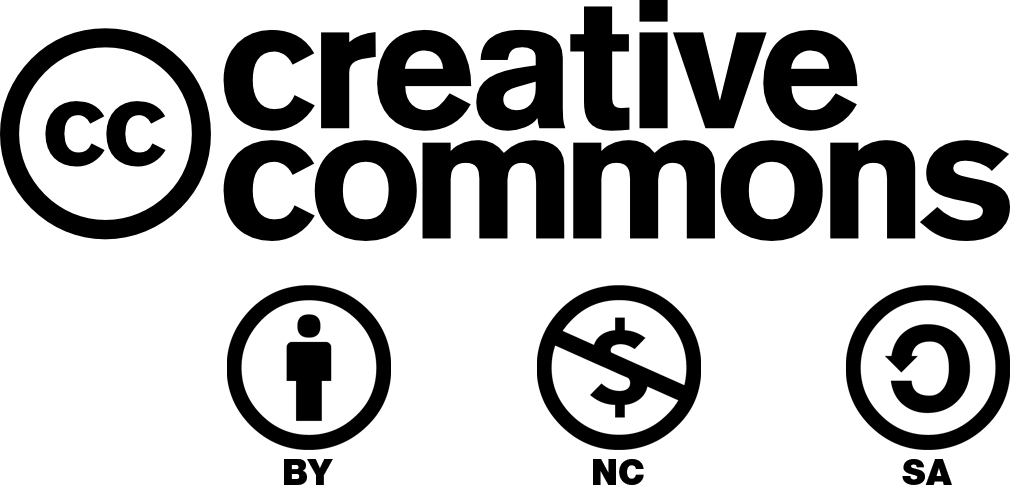
Ces informations sont mises à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Commenter
S'inscrire ou se connecter pour laisser un commentaire.