Actualités
De la gestion des incertitudes à la production de discontinuités urbaines : ce que la crue fait à la ville
Article de journal

"DEUX ANS APRÈS LA CRUE DE 2016, OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI, ALORS QUE LA RÉGION PARISIENNE A CONNU DE NOUVEAU DE FORTES PRÉCIPITATIONS AU PRINTEMPS ? QUE SE PASSERAIT-IL EN CAS D’UN ÉPISODE DE CRUE DITE CENTENNALE, AVEC DES HAUTEURS D’EAU ENTRE 6 ET 9 MÈTRES ?
Magali Reghezza-Zitt. Les deux événements récents que l’agglomération parisienne a vécu sont la crue de juin 2016 et la crue de janvier 2018. Ces événements ont entraîné des dommages importants, à cause d’inondations provoquées par des crues des affluents de la Seine. Toutefois, la formation de ces crues, l’endroit où elles se sont produites, le type d’affluent qu’elles ont concerné, la cinétique de l’aléa, les hauteurs d’eau atteintes, font que ces inondations n’ont pas grand-chose à voir avec l’événement majeur qu’on attendrait en cas de crue centennale de la Seine à Paris. Pour la crue de juin 2016, il ne s’agit pas du tout du même mécanisme de formation par exemple. Un épisode de crue qui correspondrait à un événement majeur, c’est-à-dire autour de 8 mètres ou plus à l’échelle Paris-Austerlitz, serait une crue lente, formée par des précipitations importantes répartie sur l’ensemble du bassin-versant, avec des affluents qui réagissent selon des temporalités et des cinétiques différentes. La crue de juin 2016 était une crue rapide, qui s’est formée à la suite d’un mois de mai très pluvieux et à des orages très concentrés dans le temps et l’espace, qui ont affecté le Loing et l’Yonne, en provoquant pour ces cours d’eau des inondations violentes et destructrices. En revanche, la hauteur de la Seine à Paris-Austerlitz n’a pas dépassé 6,10 mètres.
Les événements de 2016 et de 2018 se sont produits hors du centre de l’agglomération métropolitaine (Paris et la petite couronne densément urbanisée). Pour l’événement de juin 2016, on était en dehors de ce que la directive européenne inondation de 2007 a conduit à définir comme le territoire à risque important (TRI) : Paris, la petite couronne et les territoires très densément urbanisés. Pour l’événement de janvier 2018, ce sont surtout des territoires de banlieue qui étaient concernés surtout par une crue de la Marne, avec essentiellement des espaces résidentiels touchés, des caves inondées par les remontées de nappe et des réseaux largement épargnés. C’est très important de le rappeler, parce que cela veut dire que ces deux inondations sont des inondations urbaines finalement très classiques, comme on en trouve partout ailleurs en France, avec un endommagement essentiellement matériel et une crise limitée dans le temps. Si on avait un mécanisme de crue centennale avec cette fois-ci des inondations dans le centre de l’agglomération, on ne serait plus du tout dans la même configuration, parce qu’à l’inondation classique s’ajouterait un autre risque, systémique, entraînant la paralysie progressive et durable de l’agglomération, avec des conséquences durables très lourdes, non seulement pour la zone inondée, pour la région parisienne mais pour l’ensemble du pays. L’ensemble des réseaux vitaux, ce qu’on appelle les réseaux critiques – énergies, télécommunications, transports, vie quotidienne, alimentation, eau potable, assainissement – tomberaient les uns après les autres.
En cas de crue majeure, l’inondation au centre de la métropole résulterait de la combinaison trois types de mécanismes : un débordement de surface, une remontée des nappes phréatiques avec des circulations d’eaux souterraines et des interactions multiples entre les sous-sols et la surface à cause notamment de la présence de réseaux enterrés (tunnels, canalisations, collecteurs, etc.) qui vont former un réseau hydrographique bis.
Cela aurait deux conséquences. La première c’est que les territoires qui dépendent de ces réseaux, même s’ils ne sont pas en zone inondée, vont subir de graves perturbations. Sur ces territoires vivent des gens qui travaillent généralement au centre de l’agglomération ou qui effectuent des mobilités pendulaires importantes pour rejoindre d’autres périphéries. Le fonctionnement économique de l’agglomération sera ainsi fortement perturbé, avec des conséquences en chaîne sur les systèmes productifs et les salariés. Mais c’est plus largement l’ensemble des services à la population et aux entreprises qui seront dysfonctionnels, avec des conséquences fortes pour la vie quotidienne et les activités économiques. Deuxièmement, parmi les populations concernées, y compris hors de la zone inondée, il y a des acteurs de la gestion de crise qui vont être dans l’incapacité de rejoindre leur lieu de travail et d’assurer leurs missions. Les plans de continuité d’activité risquent ainsi d’être sérieusement compromis.
–
 Cliché pris à proximité de la place Louis Aragon, 4e arrondissement (M. Reghezza-Zitt, 31 janvier 2018)
Cliché pris à proximité de la place Louis Aragon, 4e arrondissement (M. Reghezza-Zitt, 31 janvier 2018)
La géographie permet-elle de penser de façon satisfaisante le risque de crue ?
Magali Reghezza-Zitt.Comprendre le risque de crue centennale en Île-de-France, c’est comprendre sa spatialité. La logique du risque urbain est une logique de continuité spatiale. La logique du risque métropolitain est celle de la discontinuité. La vulnérabilité de l’agglomération parisienne est produite par son organisation spatiale réticulaire et le caractère systémique du fonctionnement métropolitain. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on parle de risque systémique. L’organisation en archipel de la métropole, l’intrication des réseaux techniques, l’imbrication des systèmes, l’interconnexion des territoires favorisent la diffusion des perturbations et leur amplification. Les dommages ne sont plus seulement matériels et ils ne sont plus liés à l’exposition directe à l’aléa. Ils sont aussi fonctionnels avec des processus de contagion qui font que des enjeux non directement exposés à l’aléa sont soumis, par effet domino, à des perturbations majeures (et à leurs conséquences) sans avoir subi d’endommagement matériel.
Ce que les événements de juin 2016, de janvier 2018 et le grand exercice de simulation des crues Eu-Sequana, réalisé en mars 2016 ont mis en évidence, c’est que le fonctionnement métropolitain de l’agglomération est aussi dépendant du fonctionnement urbain classique (et réciproquement). Pour le dire autrement, le système métropolitain se paralyse du fait de la vulnérabilité des réseaux critiques, qui ne peuvent plus assurer la mise en relation qui permet les échanges de flux de toute nature. Mais il se paralyse aussi parce que le fonctionnement des réseaux dépend de personnes et de pratiques qui relèvent de territorialités quotidiennes qui sont perturbées par l’inondation. Sans assainissement, ramassage des ordures, ouverture des écoles ou approvisionnement des magasins, les habitants quittent leur logement et ne peuvent plus aller travailler pour faire fonctionner ces réseaux et au-delà les administrations, les entreprises, les services, la production.
Les événements récents ont finalement permis de montrer l’interpénétration des territorialités métropolitaines, qui reposent sur la connexité et la proximité relationnelle, et des territorialités urbaines classiques, qui reposent sur la proximité physique. Comprendre la vulnérabilité face à ce type de crise, c’est comprendre tout ce que la géographie urbaine nous dit sur l’habiter, les pratiques, la métropolisation, les métriques, etc.
La géographie permet par conséquent d’envisager la spatialité du risque, dans une approche systémique qui articule des métriques différentes, des échelles différentes, et pas seulement dans une perspective multi-scalaire et multi-temporelle, mais trans-scalaire et temporellement non-linéaire. L’approche systémique permet de penser les interactions complexes et de mettre en évidence une pluralité d’éléments de vulnérabilisation qui interagissent les uns avec les autres. L’entrée par le territoire est ici très pertinente.
Comprendre le risque de crue, c’est d’abord comprendre la matérialité du territoire, à la fois dans sa dimension biophysique et dans sa dimension bâtie. C’est la fameuse question du rapport-nature- société. Les dimensions physiques de l’aléa sont essentielles, par exemple pour comprendre que la crue est à cinétique lente, qu’il y a un rôle important des écoulements souterrains. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas principalement l’urbanisation qui transforme le ruissellement de surface. Localement, l’imperméabilisation des surfaces peut provoquer des débordements, mais elle n’a pas modifié tant que cela les conditions d’écoulement parce que des correctifs ont été réalisés. Là où l’urbanisation joue un rôle essentiel en revanche, c’est dans l’urbanisme souterrain. En développant l’urbanisme souterrain, on a créé un réseau hydrographique artificiel, qui est mal connu et difficile à contrôler, mais qui est en constante interaction avec les écoulements « naturels ». Cela renvoie à la question de la place de la nature dans la ville, de l’anthropisation, de l’aménagement. On voit bien l’hybridité de ces risques que l’on dit naturels : l’aléa naturel produit une panne généralisée, c’est-à-dire un risque technologique.
Dans un deuxième temps on peut s’intéresser à la vulnérabilité en tant qu’exposition et regarder comment les dynamiques spatiales ont transformé cette exposition. L’augmentation de l’exposition est liée aux dynamiques d’urbanisation et de périurbanisation, qui concernent essentiellement les territoires de banlieue et de grande banlieue. Dans ces espaces, l’exposition en zone inondable a considérablement augmenté. La densité de population et la valeur des biens se sont accrues. La croissance du risque y est finalement proportionnelle à l’urbanisation. Ces espaces concentrant souvent des activités industrielles, on peut penser à la boucle de la Seine de Gennevilliers par exemple, les risques y sont aussi technologiques (risque nat-tech). L’exposition au risque reflète aussi les héritages de l’histoire métropolitaine, avec des usages des sols différents selon les territoires. L’organisation spatiale joue aussi sur l’exposition indirecte. L’exposition indirecte s’explique par la métropolisation de l’agglomération, qui a entraîné la reconfiguration des territoires avec un processus de polarisation/spécialisation et une dissociation des lieux d’habitat, de travail, de consommation, etc. qui ont favorisé les flux de toute nature. Ceci a créé une forte dépendance aux réseaux techniques, qui sont souvent enterrés, donc exposés aux écoulements souterrains. L’organisation multipolaire de la métropole se combine avec la vulnérabilité fonctionnelle des réseaux pour créer une exposition indirecte qui fait augmenter les dommages.
Enfin, les transformations fonctionnelles du territoire agissent sur le risque. La métropolisation a engendré une recomposition des systèmes productifs, qui sont de plus en plus complexes du fait du développement de la sous-traitance, ce qui favorise des effets de contagion en dehors de la zone inondable, voire de la région. La technologisation de l’appareil productif a aussi créé une dépendance accrue aux réseaux techniques, par exemple à internet, aux télécommunications, aux données numériques.
Bref, comprendre l’exposition, c’est comprendre les conséquences des dynamiques qui ont profondément modifié l’espace urbain.
–
Comment ces évènements font-ils rejouer des inégalités à la fois territoriales et sociales ?
Magali Reghezza-Zitt. Aujourd’hui les inégalités jouent sur plusieurs plans. Les problèmes que les gestionnaires vont devoir résoudre sont d’abord liés à l’organisation du territoire entre Paris, qui concentre des fonctions régaliennes et stratégiques, et puis la banlieue et la grande couronne, où en termes de gestion de risque, les priorités sont d’abord des problèmes « humanitaires », c’est-à-dire de très nombreuses personnes, qu’il va falloir évacuer et prendre en charge sur un temps très long. La gestion de crise est un moment où les pouvoirs publics sont forcés de hiérarchiser les actions, de s’intéresser d’abord à l’urgence vitale et à la protection des infrastructures critiques qui permettent la gestion de cette urgence, ce qui fait rejouer ces inégalités territoriales et sociales. Cet impératif de priorisation est lié au contexte d’urgence mais aussi au manque de moyens financiers et humains. Il y a de moins en moins de personnes pour gérer les situations de crise, alors même que le territoire urbain et l’exposition au risque ne cessent de croître. Pour autant cette inégalité territoriale entre Paris et la banlieue ne signifie pas qu’on va abandonner la banlieue ou inonder la banlieue pour protéger Paris.
Plus largement, trois types d’inégalités au moins rejouent pendant la crise. Tout d’abord des inégalités sociales classiques liées à l’âge, au genre, au niveau d’éducation. Certaines populations sont extrêmement vulnérables du fait de leur dépendance : enfants en bas âge, mais aussi et surtout personnes âgées, personnes à mobilités réduite, personnes malades, dont la vulnérabilité s’est accrue parce qu’en temps normal, ces individus peuvent vivre seuls à domicile grâce aux progrès technologiques mais qu’ils sont ce faisant devenus totalement dépendants des réseaux qui permettent à ces progrès technologiques d’assurer leur service (électricité, téléphonie, internet, etc.).
Le rapport à la mobilité est aussi un facteur extrêmement discriminant. Il est lié au capital social avec l’insertion dans un réseau de sociabilité familial, communautaire, syndical ou professionnel, qui peut éventuellement venir se substituer aux secours traditionnels. Il est aussi lié au capital économique. Ce rapport à la mobilité dépend par exemple du taux de motorisation des ménages qui pose un vrai défi en cas d’évacuation.
On peut relever ensuite que certaines personnes, que j’appellerai des vulnérables invisibles, sont victimes de processus d’exclusion quotidienne qui va les placer dans une situation d’extrême fragilité en contexte d’urgence. Ces personnes sont rarement identifiées comme devant être prioritaire dans la prise en charge car, au quotidien, elles vivent, se débrouillent, sans aide des autorités. Je pense par exemple aux familles monoparentales, notamment aux femmes seules avec des enfants, qui en cas de crise peuvent se retrouver encore plus isolées qu’elles ne le sont, avec parfois un chômage technique qui va les précariser ou des situations extrêmement compliquées vis-à-vis de leur employeur car elles risquent de se retrouver sans solution de garde puisque les écoles seront fermées. L’évacuation de ces familles est souvent plus compliquée également. D’autres catégories de la population appartiennent à ces vulnérables invisibles : les prisonniers, les malades mentaux, déjà mal pris en charge, qui vivent dans les rues ou qui sont en hôpitaux de jour, les adolescents en rupture familiale, etc. L’ouragan Katrina en 2005 a montré leur très grande vulnérabilité. En cas de dysfonctionnement, l’isolement et l’invisibilité de ces personnes les expose davantage.
Enfin on peut identifier une troisième catégorie de population exposée au risque, c’est l’ensemble des populations marginalisées et des exclus au sens strict, et notamment des personnes en situation illégale ou irrégulière. Ce sont les migrants, ce sont les sans-domicile-fixe, les sans-papiers. Ces populations posent un double problème en termes de secours. Pour les personnes en situation irrégulière, il existe une défiance par rapport à l’autorité publique (forces de polices, armée, gendarmerie, etc.) qui va assurer la distribution de vivres, la continuité de l’accès au soin, l’évacuation (etc.). Ensuite, soit parce qu’il y a une barrière linguistique, soit parce qu’il y a une barrière sociale symbolique, ces personnes peuvent rapidement se retrouver dans un isolement total qui les empêche d’avoir accès à des informations vitales, des aides d’urgence, etc. Ce n’est pas propre aux périodes de crise mais la crise aggrave considérablement leur situation. Ces personnes peuvent aussi être dépendantes d’associations, dont le travail devient très compliqué pendant la crise. Tous les filets sociaux qui sont déjà fragiles sont souvent mis à terre en situation de crise, ce qui renforce évidemment l’isolement, la précarité, la fragilité.
Les inégalités rejouent ensuite au moment de la reconstruction et de la sortie de crise. Parce que les plus pauvres, ceux qui sont privés de capital financier, culturel ou juridique, sont ceux qui vont avoir le moins de moyens pour faire valoir leurs droits. Parce que là aussi, les inégalités sont cumulatives. L’inégalité territoriale, entre zones inondées et zones non inondées s’exprime aussi au moment de la sortie de crise. Dans les zones inondées, on comprend qu’il faut envoyer de l’aide, la solidarité joue fortement ; dans les zones non-inondées, il n’y a a priori pas de raison pour qu’on mobilise des moyens. Mais pour les populations isolées, fragilisées, qui habitent ces espaces, la situation pourra être tout aussi critique : il y aura des coupures de courant intermittentes, des problèmes d’assainissement, d’alimentation, etc.
Une crise liée à une crue centennale dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Que vont faire ces populations ? Ce type d’événement qu’on pourrait qualifier de « hors cadre », au sens que Patric Lagadec donne par exemple à ce terme, c’est-à-dire qui sort des schémas habituels de représentation et de gestion de la crise, produit des phénomènes d’ « insularisation », je reprends le terme qu’utilise Elsa Peinturier dans ses travaux de thèse sur la Nouvelle-Orléans post-Katrina. Certains territoires vont fonctionner comme des îles du fait de l’interruption des réseaux critiques et des mobilités : dans des cas particulièrement critiques, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rentrer. Et cette insularisation se retrouve sur le plan social dans des phénomènes d’isolement, et sur le plan politique avec les rapports de domination qui se rejouent dans le déroulement et la gestion de crise.
–
 Cliché pris depuis le quai Henri IV, 4e arrondissement (M. Reghezza-Zitt, 31 janvier 2018)
Cliché pris depuis le quai Henri IV, 4e arrondissement (M. Reghezza-Zitt, 31 janvier 2018)
Est-ce que depuis 2016 on a réussi à intégrer la spécificité d’une crue centennale dans le dispositif de gestion de crise ?
Magali Reghezza-Zitt. En cas de crise majeure, on a deux types d’incertitudes différentes qui vont poser des problèmes aux gestionnaires. Il y a l’imprévu, que les chercheurs et les praticiens considèrent comme l’ordinaire de la crise. Une crise, pour faire simple, c’est des tas d’imprévus. La gestion de la crise repose sur une planification qui va fournir un cadre d’action qui permet aux acteurs de faire face à l’imprévu. On identifie par exemple en amont les moyens à projeter, c’est-à-dire à mettre au bon endroit au bon moment, et ces moyens vont permettre de s’adapter à l’événement, quand il arrive. On va définir des procédures qui vont permettre de trouver des solutions alternatives en cas de panne, etc. Le « on », ce sont aussi bien les services de l’État que des acteurs locaux, publics ou privés.
Dans le cas d’une crue centennale, il existe aussi de l’imprévisible structurel, qui fait qu’on est parfois obligé de prendre des décisions à l’aveugle. Par exemple, il est impossible d’annoncer l’évolution du niveau de l’eau à plus de 72 heures. Ce n’est pas lié à un manque de connaissances ou de compétences mais à la dynamique biophysique du bassin-versant. Pourtant, les plans d’évacuation, de mise en sécurité, de protection nécessitent souvent plus de 72 heures pour être mis en œuvre, ce qui signifie que les gestionnaires devront sans doute parfois les lancer pour rien. Qui prend la décision (et donc la responsabilité) de les lancer ? Plus largement, du fait du caractère systémique de la crise, il est très difficile d’anticiper les conséquences de telle ou telle perturbation, de telle ou telle action ou de telle ou telle décision.
Dans ce type de crise, n’importe quel acteur peut être confronté à une situation qui demande de prendre une décision lourde de conséquences sans disposer des éléments suffisants pour pouvoir s’appuyer sur les raisonnements coûts-bénéfices habituels. Cela concerne tout le monde : le professionnel sur le terrain, l’élu local, les personnes qui sont dans les cellules de crise intermédiaires, le centre opérationnel de crise à l’échelon départemental ou zonal, les chefs d’orchestre qui déploient les moyens, etc. Cela fait peser de grandes responsabilités sur les individus. Il faut aussi prendre désormais en compte la pression des médias et de l’opinion. Enfin, dans le cas d’une crue majeure, tous les acteurs sont dépendants des décisions des autres, alors qu’ils n’en ont qu’une visibilité partielle. Cela accroît l’incertitude et complique encore la prise de décision.
En termes de cartographie des réseaux hydrographiques, et notamment des réseaux hydrographiques bis, est-ce qu’il y a eu des progrès depuis 2016 ?
Magali Reghezza-Zitt. Grâce à la directive européenne de 2007, les territoires à risques importants doivent disposer de diagnostics de risque. La mise en œuvre de la directive a permis de produire de nouvelles cartes et d’améliorer la connaissance. On a donc des cartes de hauteur d’eau et d’inondations de surface, que certains acteurs ont cependant beaucoup de mal à interpréter. De plus, ces cartes ne sont pas dynamiques, elles donnent seulement une idée de l’enveloppe de l’inondation. Le problème est de pouvoir disposer en situation de crise d’une cartographie évolutive, qui permette de prendre en compte les imprévus (rupture de digue ou de murettes, résurgence d’assainissement) et l’imprédictible (évolution de la cinétique de crue, interactions entre surface et sous-sols, etc.). En ce qui concerne les réseaux souterrains, on a très peu de connaissances sur la circulation d’eau dans le sous-sol. On a d’ailleurs une connaissance très partielle du sous-sol parisien, qui est un vrai gruyère. Une partie relève du privé, par exemple les caves de particuliers, et on ne sait pas ce que ces gens ont fait de leur sous-sol.
Une des façons de contourner le manque de moyens pour cartographier le sous-sol est de recourir à la cartographie collaborative. En janvier 2018, la mairie de Paris, grâce à son Service des Carrières, avait mis en place de façon efficace une cartographie des caves inondées, même si une cartographie collaborative à plus large échelle est compliquée à mettre en place.
–
Dans ce contexte d’élaboration de la gestion de crise, comment les acteurs impliqués se posent-ils la question de la résilience face à la catastrophe ? Intègre-t-on les enjeux de résilience à la planification urbaine ?
Magali Reghezza-Zitt. La résilience est devenue un mot très à la mode, pour deux raisons principales. La première, c’est que cela a permis à la fois aux acteurs de gestion de crise d’arriver à attirer l’attention sur le fait que la crise était inéluctable, mais que ce constat ne condamnait ni au fatalisme, ni à l’inaction. La résilience devenait un palliatif à l’échec de la prévention. C’était une façon de pouvoir dire les limites des mesures de mitigation et de réduction de l’exposition, tout en martelant que la réduction de la vulnérabilité restait absolument nécessaire quoiqu’insuffisante. Cela a aussi permis de déplacer le curseur de la protection vers la continuité d’activité, le redémarrage, la reconstruction. Cela a enfin permis de faire de la question des réseaux critiques une question prioritaire.
La deuxième raison, c’est que c’est un terme à connotation positive. Il est plus facile pour un territoire de parler de risque à travers la résilience que la vulnérabilité. Par exemple, la ville de Paris a obtenu la reconnaissance de la Fondation Rockefeller et a adhéré au réseau des 100 villes résilientes. Elle a adopté une stratégie de résilience, avec 32 propositions d’actions concrètes. En parallèle, la stratégie locale de gestion des risque inondation (la SLGRI), qui fixe un cadre d’aménagement pour le territoire à une échéance de 30 à 50 ans, a permis l’adoption d’une charte sur les quartiers résilients. Si on s’intéresse à un versant plus territorial de la résilience, la particularité en Ile-de-France, c’est que tout est construit. Les enjeux de résilience sont donc essentiellement des enjeux de renouvellement urbain. C’est intéressant parce que cela ouvre de nouvelles perspectives d’aménagement, qui permettent d’intégrer à la fois les impératifs de durabilité, d’adaptation au changement climatique, de transition écologique, d’inclusivité, de justice sociale et spatiale. Là encore, la résilience est un terme suffisamment flou et plastique pour permette aux acteurs de l’interpréter comme ils le souhaitent, y compris pour donner un contenu concret à des injonctions jusque-là très incantatoires.
On assiste aujourd’hui à une convergence autour d’un terme dont les acteurs du territoire ignorent le sens précis mais qui est suffisamment plastique pour offrir une interprétation qui satisfasse tout le monde et crée le consensus. La résilience peut être pour certains une notion qui permet de changer de pratique, voire de créer de nouveaux paradigmes, alors qu’elle sera pour d’autres une façon de ne surtout rien changer en habillant d’un vocable neuf des pratiques anciennes. La résilience a au moins l’avantage d’être une notion fédératrice, un peu comme le développement durable, qui permet d’intégrer tous les volets d’un problème complexe et donc, de faire que les gens se parlent et décloisonnent davantage leurs pratiques : de la prévention du risque à la gestion de crise et au relèvement post-catastrophe, en articulant tous les corps de métiers et toutes les temporalités, c’est-à-dire le temps très court de la gestion de crise, le temps moyen de l’amélioration de l’existant, de la protection et de la réduction de la vulnérabilité, et le temps long du renouvellement urbain. Le problème, c’est que la résilience est parfois aussi un prétexte pour renforcer la ville néo-libérale dans ses pires aspects, pour renforcer le transfert des coûts de la sécurité sur les individus et les collectivités territoriales, pour justifier de la réduction des missions régaliennes de l’État et des moyens qui sont associés et pour certains, pour encourager le laisser-faire, voire le laisser-faire n’importe quoi.
La résilience est finalement à la fois quelque chose d’extrêmement positif et d’extrêmement toxique, selon les acteurs qui l’utilisent et la façon dont ils l’utilisent. Elle est performative, c’est-à-dire que les acteurs en Île-de-France donnent aujourd’hui à cette notion un contenu opérationnel au moment où ils la mettent en œuvre et s’interrogent sur sa signification.
–
 Cliché pris à proximité de la place Louis Aragon, 4e arrondissement (M. Reghezza-Zitt, 31 janvier 2018)
Cliché pris à proximité de la place Louis Aragon, 4e arrondissement (M. Reghezza-Zitt, 31 janvier 2018)
Quels défis la gouvernance de la région Ile-de-France pose-t-elle par rapport à la gestion de crise ?
Magali Reghezza-Zitt. Le territoire est très fragmenté du point de vue des acteurs, notamment sur le plan politique, dans un contexte marqué par l’émergence du Grand Paris, et les jeux d’acteurs complexes et mouvants entre la ville de Paris, les communes de banlieue proche et les communes de grande couronne, y compris les communes rurales, la région, les départements, etc. S’ajoutent en outre des acteurs privés ou semi-publics très puissants.
La particularité est que Paris est une capitale politique, et qu’on a donc sur le territoire une présence particulière de l’État et des fonctions régaliennes, une proximité physique au pouvoir politique central, redoublée du fait que beaucoup d’élus, jusqu’à la réforme du cumul des mandats, étaient des élus locaux, des membres d’exécutifs départementaux ou régionaux, des députés ou des sénateurs, parfois des ministres. Par ailleurs Paris est une commune, un département, mais la maire ne dispose pas des pouvoirs de police, on a donc un poids particulier de la Préfecture de police, qui est aussi une préfecture de zone de défense.
C’est donc un système très complexe d’acteurs, avec des coalitions d’intérêts qui sont très fluctuantes et conditionnées par des temporalités politiques et électorales qui ne sont pas forcément alignées les unes sur les autres. L’un des défis de la gouvernance à l’échelle métropolitaine est celui de la coordination entre les différents acteurs publics, entre les opérateurs et l’État, entre les collectivités territoriales, le Grand Paris en création, l’État et ses administrations déconcentrées, etc. Ce n’est pas propre à la question des risques mais la question des risques permet de comprendre les difficultés de la gouvernance régionale et métropolitaine.
Le jeu d’acteurs a en outre beaucoup évolué avec l’émergence régulière de nouveaux protagonistes. Du fait de la libéralisation de certains secteurs autrefois publics, on a une multiplication des opérateurs, ce qui demande aux services de l’État en charge de la gestion de multiplier le nombre d’interlocuteurs, de les considérer comme des partenaires, et de trouver des solutions pour les faire discuter entre eux pour qu’ils échangent des données, etc.
Certains changements sont à l’origine d’une augmentation de la vulnérabilité. Par exemple, la plupart des institutions publiques ont externalisé un certain nombre de services. Cela les rend particulièrement vulnérables, parce qu’elles dépendent d’entreprises privées extérieures. La précarisation des contrats de travail et le fait qu’aujourd’hui on n’embauche non plus sur des postes de fonctionnaires, mais sur des postes de contractuels précaires accentue le turn over dans les administrations. Cela empêche souvent de capitaliser l’expérience et les connaissances. L’organisation en est fragilisée lorsque la crise survient. Dans le privé, la multiplication des emplois précaires et des contrats temporaires pose aussi problème. Il est difficile d’attendre d’un contractuel d’avoir le même sens du service public ou de l’entreprise que chez une personne ayant un emploi stable. L’expérience montre pourtant qu’en cas de crise, la gestion repose aussi souvent sur l’implication et le dévouement des individus qui se mettent au service de leur entreprise ou du collectif.
Et puis, il y a la question de la prise en compte des citoyens. Ce qui est assez frappant, c’est l’absence de débat public, au niveau local, au niveau régional, et au niveau national sur ces questions de risques majeurs, sur ce qui est acceptable et tolérable en matière de gestion de risques, de gestion de crise et de sécurité. On est dans une situation pleine de contradictions. Certains acteurs réclament plus de la responsabilité individuelle et veulent faire du citoyen un acteur de sa sécurité (conformément à la loi), mais ces mêmes acteurs agissent sans impliquer les citoyens. Inversement, de nombreux citoyens réclament toujours plus de sécurité, mais en voulant payer toujours moins et en en appelant systématiquement à l’État.
Bref, la gouvernance est un réel enjeu qui fonctionne cependant encore beaucoup sur le mode de l’incantatoire. Dire qu’il est nécessaire d’améliorer la gouvernance ne dit pas comment s’y prendre.
–
Comment peut-on préparer les populations civiles et les acteurs, les sensibiliser à ces enjeux ?
Magali Reghezza-Zitt. En fonction des temporalités de la crise, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont concernés. La réduction de la vulnérabilité de l’agglomération reste un objectif essentiel. Sur le temps long, les enjeux sont ceux de l’aménagement du territoire et du renouvellement urbain. Sur le moyen terme, les problèmes sont ceux de la réduction de la vulnérabilité, qui passe très largement par des mesures techniques et par une évolution de la société dans son rapport à la sécurité et aux comportements. Sur le très court terme, les enjeux sont ceux de la préparation des gestions de crises hors cadre, où à mon sens la priorité est de former tous les acteurs de la gestion de crise.
On confond souvent en France la gestion de crise avec la sécurité civile. Effectivement, sur le terrain, on a des acteurs de la sécurité civile, comme les pompiers, le SAMU, des associations, appuyés par des acteurs de la sécurité publique comme la police, la gendarmerie, l’armée, qui d’ailleurs remplissent aussi parfois des missions de sécurité civile. La gestion de crise est le fait des opérateurs de réseau, des entreprises, des administrations, qui sont sur le terrain et se préparent par des exercices. Les citoyens ont aussi un rôle à jouer, soit individuellement, soit par le biais de collectifs (associations, syndicats, etc.). En revanche, au sein des cellules de crise, on trouve, au côté de professionnels rompus à l’exercice, des personnels dont ce n’est pas le métier et qui ne sont pas formés. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, n’importe quel salarié peut se retrouver gestionnaire de crise. C’est là que ce problème de gestion de crise devient un problème de ressources humaines, et aussi un problème éthique puisque ces gens ont soudainement des responsabilités morales très grandes. Dans certains cas, ils doivent prendre des décisions très lourdes, dont ils ne peuvent apprécier la pertinence qu’a posteriori. Dans une gestion de crise hors-cadre, il n’y a pas de bonne décision a priori au sens où il n’y a pas de réponse toute faite, de manuel à appliquer à la lettre. Il y a des décisions qui conduisent à des réponses qui vont se révéler plus ou moins appropriées. Il y a là un véritable enjeu, puisque la responsabilité de ces acteurs de la gestion de crise est non seulement morale mais aussi juridique.
La préparation des populations est un sujet extrêmement compliqué, il n’y a pas de recette miracle. Une fois qu’on a dit qu’il fallait développer la culture du risque, on n’est pas plus avancé. La sensibilisation à ce type d’événements doit prioritairement toucher les élus, les gestionnaires et les entreprises avec une continuité dans le temps. Pour l’instant, malgré des progrès notables, la sensibilisation reste très inégale. Pour les citoyens au sens large, il existe déjà un arsenal de mesures dont certaines sont encadrées par la loi : information au moment de l’acquisition d’un bien immobilier par les notaires, information dans les mairies grâce aux DICRIM (Document d’information communal sur les risques majeurs), etc. Les assureurs contribuent de plus en plus à l’information préventive. On observe aussi la pose de repères de crue, etc. Les médias font régulièrement de la communication sur le sujet. Il existe aussi des conférences, des expositions, des brochures, des documentaires. Bref, l’information existe mais elle ne semble pas très efficace. De plus, beaucoup de responsables politiques restent frileux à l’idée de parler de ce sujet : peur d’effrayer, peur aussi de donner une mauvaise image du territoire. La sensibilisation aux risques et la préparation à la crise demande un travail long et continu, qui doit mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire mais aussi être porté par les élus, avec une volonté politique forte. L’expérience montre que jusque-là, seuls des événements graves ont été capables d’entraîner une mobilisation durable et un changement des pratiques et des comportements. Le défi est donc de construire la sensibilisation et la préparation en dehors de ces événements.
Magali Reghezza-Zitt est maître de conférences, habilitée à diriger des recherches à l’École normale supérieure (PSL), membre du laboratoire de géographie physique de Meudon (LGP-UMR 8591), co-directrice du Centre de formation sur l’environnement et la société (CERES). Géographe de l’environnement, elle travaille en particulier sur les risques naturels, les questions de vulnérabilité et de résilience urbaines et métropolitaines, d’incertitude et de gestion de crise. Sa thèse soutenue en 2006 portait sur la vulnérabilité de la métropole francilienne face au risque de crue centennale. Elle participe aujourd’hui à plusieurs conseils scientifiques (Association française de prévention des catastrophes naturelles, Centre européen de prévention de risque d’inondation, Stratégie locale de gestion du risque inondation en Îlede-France, etc.) et collabore avec les acteurs locaux, régionaux et nationaux. "
–
Contributeur
Licence
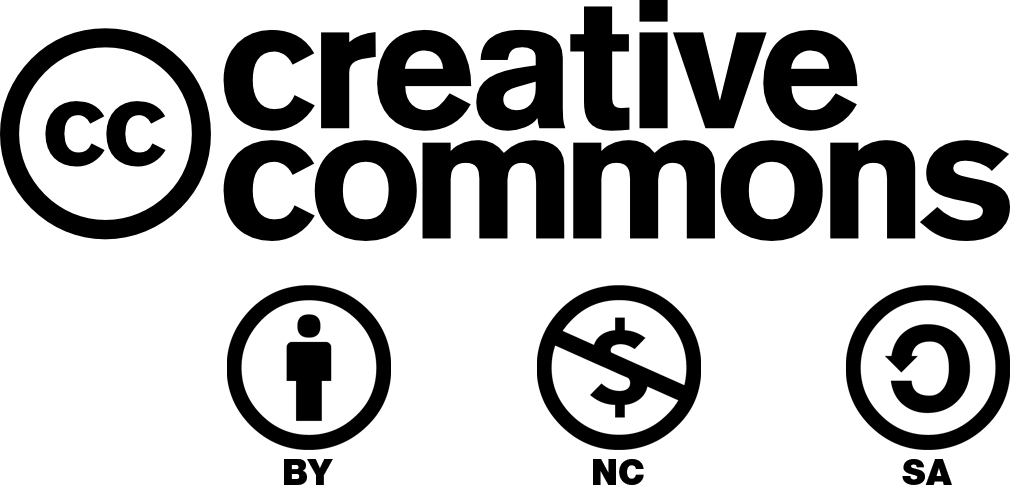
Ces informations sont mises à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Commenter
S'inscrire ou se connecter pour laisser un commentaire.